La Méditerranée continue d'être un cimetière silencieux pour de nombreux jeunes Africains. Malgré les dangers bien connus des routes migratoires irrégulières, des centaines d'entre eux risquent leur vie pour rejoindre l'Europe, poussés par le désespoir et le manque de perspectives économiques. À Sokodé, ville meurtrie par plusieurs naufrages en mer, les familles pleurent leurs proches tout en s'interrogeant sur les moyens de freiner ces tragédies répétées. Entre récits de deuil, témoignages de survivants et initiatives locales pour sensibiliser les jeunes ou les soutenir économiquement, ce reportage plonge au cœur d'une problématique où l'espoir et le drame s'entrecroisent.
Par Fousseni SAIBOU
Dans la nuit silencieuse du 26 avril 2021, bien avant l'appel matinal du muezzin, une nouvelle bouleversante s'est répandue à Sokodé, une ville située au centre du Togo, majoritairement musulmane. Plusieurs jeunes de cette localité, ainsi que d'autres pays africains, partis en quête d'un avenir meilleur, ont péri dans les eaux tumultueuses de la Méditerranée. Cette série de drames, annoncée deux jours plus tôt par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), illustre tragiquement le lourd tribut payé par les migrants togolais dans leur quête désespérée de l'Europe.
Un drame qui touche plusieurs familles
Selon l'Association Togolaise des Expulsés (ATE), une organisation de défense des droits des migrants, neuf familles de Sokodé ont perdu des proches dans ces naufrages. Aboubakari Razakou, coordonnateur de l'ATE, décrit une situation déchirante : «Après nos enquêtes, nous avons identifié des familles de victimes dans les quartiers de Didaourè, Salimdè et Kpangalam. Ces jeunes espéraient une vie meilleure en Europe, mais leur rêve s'est transformé en cauchemar »
La douleur était particulièrement vive dans le quartier de Didaourè, où la disparition d'un jeune homme connu pour sa joie de vivre avait plongé les habitants dans une profonde tristesse. Son frère aîné se remémore avec émotion le moment où la tragédie s'est révélée : « La nouvelle est tombée au milieu de la nuit. Notre frère, basé à Lomé, nous a appelés pour annoncer que le cadet avait embarqué sur un bateau qui n'est jamais arrivé à destination. C’était pendant la période de jeûne du Ramadan. J’ai attendu que tout le monde ait fini de manger à 5 heures du matin pour leur annoncer la terrible nouvelle. »
Le chef spirituel de Sokodé, El-Hadj Nasser Issa Touré, habitant de Didaourè, est profondément ému par ce drame qui frappe au cœur de sa communauté.

« C’était vers une heure du matin que j’ai appris ce drame. Cette fois-ci, c’est vraiment trop. Il faut que nous trouvions des solutions pour éviter que cela ne se reproduise.
El-Hadj Nasser Issa-Touré
Ces témoignages émouvants mettent en lumière les tragédies humaines qui frappent régulièrement les familles de Sokodé. En effet, ce drame n'est malheureusement pas le premier à endeuiller la ville. En 2007 et 2012, de nombreux jeunes de Sokodé ont perdu la vie dans les eaux du golfe de Guinée en tentant de rejoindre le Gabon. Plusieurs autres drames ont eu lieu en Méditerranée, dont celui de 2018. Cependant, les chiffres exacts des ressortissants de Sokodé péris dans les naufrages ne sont pas connus.
Il est en effet difficile de dresser un bilan précis des pertes humaines liées aux naufrages des migrants clandestins, car ces derniers surviennent souvent dans un anonymat total. Selon Flavio Di Giacomo, porte-parole de l’OIM, de nombreuses embarcations de fortune pourraient avoir sombré sans laisser de traces. D’après son organisation, 2 013 personnes ont perdu la vie en Méditerranée en 2023 en tentant de rejoindre l’Europe. Pour Yves Aubaud, président de l’association Colibri–Afrique–France, « ces chiffres ne représentent que ce que nous connaissons vu d'Europe. Mais si l’on ajoutait tous les Africains partis d’Afrique pour tenter de traverser vers l'Europe, il faudrait multiplier ce chiffre »
Des vies brisées, des souvenirs gravés à jamais
Les survivants des drames migratoires portent en eux les stigmates d'une tragédie indélébile. Leurs parcours, marqués par des périls, des pertes humaines et des souvenirs traumatiques, illustrent l'immensité des défis auxquels sont confrontés les migrants. À Sokodé, leurs récits dévoilent non seulement l'ampleur de ces épreuves, mais aussi la résilience et le courage qui les animaient dans leur quête d’un avenir meilleur.
Parmi les rares rescapés de ces naufrages, Zoubérou surnommé ZBT, un jeune homme originaire de la localité, incarne la survie face à l'impossible. Son histoire, devenue emblématique dans son quartier d'origine, 'Kpalo-Kpalo', est celle d'une lutte acharnée contre la mort. En 2018, alors qu'il tentait de traverser la Méditerranée centrale avec des dizaines d'autres migrants, leur embarcation de fortune a sombré dans les eaux glacées. « Nous étions à bord d'une pirogue en bois, solide, mais incapable de résister à la violence des vagues ce jour-là. Quand elle a commencé à se fissurer, nous savions que la catastrophe était inévitable. Les cris, les pleurs… tout était confus. Ceux qui savaient nager n'ont pas survécu plus longtemps que les autres. La mer n'a fait aucune distinction », raconte-t-il.

Naufrage au large des côtes italiennes ayant fait près de 60 morts
Pendant plusieurs heures, ZBT et trois autres survivants ont affronté les eaux, agrippés à des débris. «Nous étions à bout de forces quand des pêcheurs libyens nous ont secourus. Ils nous ont sauvés de justesse. Mais ce que j'ai vu cette nuit-là me hantera pour toujours : des amis, des frères que je ne reverrai jamais », raconte-t-il, avant de poursuivre : « Comment expliquer à ceux qui sont restés que leur douleur était inutile ? Cela m'a profondément changé. Aujourd’hui, je raconte mon histoire pour éviter que d’autres jeunes ne connaissent le même sort.»
La famille de ZBT, persuadée qu'il faisait partie des victimes de ces naufrages, avait déjà organisé ses funérailles, avant d'apprendre qu'il a survécu.
Le désert du Sahara : un tombeau à ciel ouvert
Pour de nombreux migrants d’Afrique subsaharienne, le périple vers l’Europe commence à Agadez, au Niger, un carrefour clé du trafic migratoire. De là, ils s’engagent dans une traversée périlleuse du désert du Sahara jusqu’en Libye, souvent entassés dans des camions surchargés. Des haltes dans des oasis comme Dirkou permettent de se reposer avant de reprendre une route semée de dangers.
Cette traversée, étape incontournable pour atteindre l’Europe, est aussi l’une des plus meurtrières. Selon l’OIM, sur les plus de 7 400 décès de migrants enregistrés en Afrique entre 2014 et 2019, une grande partie s’est produite dans le Sahara. Ce périple, qui dure plusieurs jours, voire des semaines, expose les voyageurs à des conditions extrêmes : chaleur accablante le jour, froid glacial la nuit, manque d’eau et de nourriture, sans compter les violences des passeurs et les accidents.
« Ce qui se passe dans le désert est vraiment dramatique. Beaucoup meurent de faim, de soif, faute de nourriture et d’eau pour survivre », souligne Aboubakari Razakou.
Les véhicules utilisés pour ces traversées sont souvent vétustes et surchargés, augmentant les risques de panne ou d’accident. Le désert est jonché de traces de ces tragédies : des corps abandonnés dans le sable. Ces décès ne sont pas uniquement dus aux conditions naturelles, mais aussi à l’abandon par les passeurs. Lorsqu’un migrant tombe malade ou devient incapable de continuer, il est souvent laissé sur place, condamné à une mort certaine.
Koudjow, un migrant originaire de Sokodé, aujourd’hui installé en Italie, se souvient avec amertume de son voyage en 2017. « Nous étions en convoi, roulant à vive allure. Ceux qui tombaient par erreur, le chauffeur ne revenait jamais les chercher. On restait collés les uns aux autres jusqu’à Sebha, une ville stratégique pour le commerce entre la Libye, le Niger, le Tchad et d'autres pays de la région sahélienne. La sécurité, les militaires, les bandits, tous résident la-bas. Donc la voie était compliquée pour rejoindre Tripoli.», raconte-t-il.
Les tempêtes de sable, souvent violentes, sont fréquentes dans cette région. Elles désorientent les migrants et les véhicules en effaçant les traces laissées par les convois précédents, rendant la navigation encore plus hasardeuse.
Malgré ces horreurs, beaucoup poursuivent leur périple, animés par l’espoir d’un avenir meilleur. Mais pour d’autres, le Sahara devient un cimetière silencieux, où s’éteignent leurs rêves et, parfois, leurs vies. Ces tragédies, invisibles aux yeux du monde, rappellent l’ampleur du drame humain qui se joue dans ce désert inhospitalier.
Enlèvements, esclavage, exploitation sexuelle : le quotidien tragique des migrants en Libye
De nombreux migrants africains subissent des formes modernes d'esclavage lors de leur passage en Libye, un fléau documenté par des organisations internationales à travers des témoignages glaçants. Coincés dans ce pays en raison de conflits, d'instabilité politique et de politiques migratoires restrictives, ils deviennent des proies faciles pour des réseaux criminels. Ces migrants sont souvent capturés, détenus dans des conditions inhumaines et vendus comme de simples marchandises. Forcés de travailler sans rémunération, certains sont également victimes d'exploitation sexuelle. Cette situation alarmante reflète un système impitoyable où la dignité humaine est sacrifiée au profit d'intérêts économiques, dans l'indifférence générale de la communauté internationale.

Image de migrants en captivité en Libye
Une autre pratique courante en Libye est l'enlèvement, orchestré par des milices, des trafiquants d'êtres humains et parfois même par des groupes armés. Les migrants sont interceptés et retenus de force dans des camps ou des centres de détention clandestins. Un rapport de l'Organisation des Nations Unies (ONU) indique qu'en 2019, environ 3 000 migrants en ont été victimes, avec des demandes de rançon atteignant parfois plusieurs milliers d'euros.
Les méthodes utilisées par les ravisseurs pour contraindre les parents des victimes à payer des rançons sont souvent cruelles. Ils soumettent les migrants à des séances filmées de torture physique et mentale, puis envoient les vidéos aux parents pour leur extorquer des sommes exorbitantes. Koudjow a été témoin de cette pratique lors de son passage à Sebha, un hub migratoire en Libye. « On t’arrête, on t'emprisonne, on te manipule pour que tu sois obligé de leur donner le numéro d'un parent. Chaque jour, on te traite comme un esclave, on te bat, espérant que tes parents entendent les menaces et se décident à envoyer de l'argent », raconte-t-il.
En cas de non-paiement de rançon par les familles, les victimes sont souvent revendues à d'autres trafiquants, qui les exploitent dans des réseaux de travail forcé ou d'esclavage sexuel. « Un Arabe peut te prendre et te vendre à un autre. Celui-ci devient ton hôte et réclame de l'argent avant de te libérer », précise-t-il.
Ceux qui parviennent à survivre sont laissés pour compte dans des conditions inhumaines. Peu d'entre eux parviennent à franchir l'étape décisive : la mer, dernier obstacle avant d'atteindre l'Europe. Koudjow a réussi à y parvenir, mais il n'arrive toujours pas à se défaire des souvenirs de cette traversée traumatisante.
Le fardeau du deuil et l'espoir fragile des familles
Que les disparitions aient lieu en mer ou dans le désert, les chances pour les familles de retrouver leurs proches, vivants ou morts, restent extrêmement faibles. L'absence de corps rend le deuil encore plus difficile. À Sokodé, les familles des disparus organisent parfois des obsèques symboliques, tout en gardant l'espoir d'un miracle. « Même après les funérailles, j’ai du mal à accepter qu’il soit mort. J’espère qu’un jour, quelqu’un nous appellera pour nous dire qu’il est vivant », confie le frère de la jeune victime de Didaourè.
Dans la plupart des cas où les corps sont retrouvés, il se pose le problème de leur identification. En effet, les corps sont souvent difficiles à reconnaître, sauf lorsqu'ils sont retrouvés avec des pièces d'identité. Ryaw, un jeune de Sokodé, a été emporté par le naufrage de 2007 au large des côtes camerounaises alors qu'il tentait de rejoindre clandestinement le Gabon pour une vie meilleure. Sa famille a appris son décès grâce à sa carte d'identité.
« À l'époque, seul un parent dans notre quartier avait un téléphone, et tout le monde l'utilisait pour les démarches administratives, comme établir une carte d'identité. On mettait son numéro comme personne à prévenir. Un jour, il a reçu un appel du Cameroun. On lui a demandé s'il connaissait Ryaw, et il a répondu : "C'est mon fils." », relate un de ses frères.
La nouvelle qui a suivi a été un choc pour ce parent, car il n'était pas au courant du voyage de son fils.
« On lui a alors annoncé : "Le corps de votre fils a été retrouvé sur la côte camerounaise." Le parent a demandé si le corps pouvait être rapatrié, mais on lui a répondu que le naufrage remontait à plus d'une semaine », a-t-il poursuivi.
En effet, le corps du jeune homme était déjà gonflé au moment de la découverte, et c'est en déchirant ses vêtements que la police camerounaise a trouvé sa carte d'identité plastifiée, avec le numéro de téléphone de la personne à prévenir.
Face à ces tragédies migratoires, des organisations comme le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) tentent de mettre en contact les disparus vivants avec leurs familles ou d'identifier les corps des victimes grâce à son département appelé "Rétablissement des liens familiaux".
Il existe d'autres initiatives pour venir en aide aux migrants en détresse dans le désert.
« Nous, en tant que réseau d’associations travaillant sur les questions migratoires, avons créé ce que nous appelons 'Alarm Phone Sahara'. C’est une ligne téléphonique d’urgence que tout migrant en détresse dans le désert du Sahara peut appeler pour être secouru », explique Aboubakari Razakou.
Afin de faciliter leur repérage et d’augmenter leurs chances de survie, les organisations conseillent aux migrants de prendre certaines précautions avant de se lancer dans leur périple. Parmi ces recommandations figurent : la conservation de documents d’identité, l’utilisation de dispositifs de géolocalisation et le maintien d’une communication régulière avec leurs proches. S’inscrire auprès d’organisations humanitaires et intégrer des réseaux de soutien peuvent également offrir une meilleure visibilité et une aide en cas d’urgence. Par ailleurs, il est essentiel pour les candidats à la migration de se renseigner sur les itinéraires les plus dangereux, d’éviter les situations à haut risque et de prévoir un plan d’urgence en cas de disparition.
Ces mesures, bien que simples, peuvent considérablement améliorer la sécurité des migrants et augmenter leurs chances d’être retrouvés en cas de problème, tout en réduisant les risques associés à ce voyage périlleux.
La sensibilisation, un rempart contre la migration clandestine
La libre circulation des personnes est un droit fondamental consacré par l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Par conséquent, nul ne peut empêcher les migrants de partir, de revenir ou d'emprunter des voies dangereuses. Face à cette réalité, les organisations se limitent à mener des campagnes de sensibilisation pour alerter les migrants potentiels sur les risques encourus sur ces routes.
Depuis la disparition des jeunes de Sokodé dans les naufrages d'avril 2021, une vaste mobilisation a été lancée par les natifs de Sokodé. Les leaders communautaires, les associations, ainsi que la diaspora togolaise en Europe et aux États-Unis ont intensifié les campagnes de sensibilisation à travers divers canaux : réseaux sociaux, radios, télévisions, mosquées et démarches de porte-à-porte.
L'association Didaourè Bia, qui regroupe les natifs de Didaourè, joue un rôle particulièrement actif dans cette initiative. Téouri Sabirou, son trésorier général, explique : « Lors de nos campagnes de sensibilisation, nous disons aux jeunes : “Attention, nous n'avons pas les moyens de vous retenir ici. Nous n'avons pas de solution à Sokodé, mais si vous souhaitez partir, empruntez des routes relativement sûres. La voie maritime est à proscrire.” Nous martelons ce message à chaque occasion. Le passage par le Sahara est extrêmement dangereux, et tout le monde a vu les images qui circulent sur les réseaux sociaux. »
Les passeurs, connus sous le nom de 'coxeurs', exercent une forte emprise sur les jeunes, leur faisant miroiter des logements décents et un travail facile en Europe. Un autre défi majeur pour l'association Didaourè Bia est d’identifier les complices de ces passeurs au sein de la communauté et de les sensibiliser.
« Nos enfants qui sont en Libye ont des connexions avec ceux d’ici qui facilitent ce trafic. L’argent passe par eux avant que les candidats ne se préparent à partir. Les passeurs ont de l’influence parce qu’ils sont soutenus par ces complices locaux. Si nous parvenons à maîtriser ceux qui sont ici, s'il plaît à Dieu, nous pourrons résoudre une grande partie du problème », a déclaré Azia Adiétou Katakpaou, membre de cette association.
« Nous connaissons leurs familles, et souvent, nous discutons avec elles ainsi qu’avec les natifs impliqués dans ce fléau. Nous les sensibilisons petit à petit, à travers des discussions informelles, sans qu’ils ne se rendent compte que nous agissons dans ce sens », a-t-elle ajouté.
Des alternatives pour freiner la migration clandestine
Pour réduire la migration irrégulière, certaines organisations s'efforcent de résoudre les problèmes de chômage chez les jeunes, identifiés comme l'une des principales causes du phénomène migratoire. Bien que le taux de chômage ait diminué depuis 2011 au Togo, il demeure préoccupant parmi la jeunesse, s'établissant autour de 5 %, selon la Direction de l'Emploi des Jeunes du ministère du Travail.
En Afrique, les mutations du marché du travail soulèvent également la question de l'inadéquation entre les compétences des jeunes et les besoins des entreprises, une des causes majeures du sous-emploi au Togo. Parmi les jeunes de Sokodé ayant péri en mer entre 2007 et 2021, beaucoup possédaient des qualifications professionnelles, mais étaient confrontés au chômage ou au sous-emploi. C'était le cas de Riyaw, titulaire d'un CAP en maçonnerie, qui avait pris la route du Gabon alors que ses parents le croyaient encore à Lomé, tentant de s'en sortir.
L'association Didaourè Bia s'est engagée à apporter des solutions concrètes à ces problématiques.
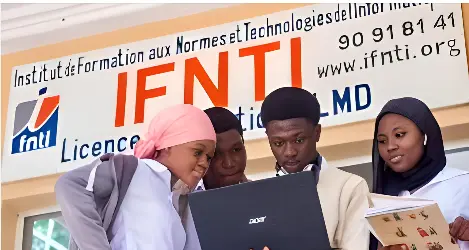
Etudiants de l'IFNTI de Sokodé
Téouri Sabirou, trésorier général de l’association et directeur des études à l'Institut de Formation aux Normes et Technologies de l'Informatique (IFNTI) à Sokodé, précise : « L’un des objectifs de Didaourè Bia est de sortir la jeunesse de la précarité. Pour cela, nous accompagnons les jeunes dans leur formation scolaire afin de leur garantir une éducation de qualité. Nous veillons à ce qu’ils bénéficient d’une solide préparation, car une bonne formation augmente leurs chances d'accéder à l'emploi. Nous mettons un accent particulier sur la qualité de l’apprentissage, avec l’ambition de former des jeunes compétitifs sur le marché de l’emploi au niveau national dans les années à venir. »
La mise en avant d'autres alternatives viables, telles que les programmes de développement économique, offre des perspectives concrètes susceptibles de réduire l'attrait pour ces voyages souvent mortels. Dans cette dynamique, l'Association Togolaise des Expulsés appuie les jeunes dans la création de microprojets. « Nous leur suggérons des idées et les encourageons à élaborer de petits projets que nous pouvons soutenir localement, afin que chacun puisse trouver une occupation. Par ce biais, nous leur montrons indirectement que rester chez soi peut être une meilleure option », explique Aboubakari Razakou.
Cette approche est également partagée par l'association Colibri-Afrique- France, qui aide les jeunes à formaliser leurs idées d'entreprise, quel que soit leur niveau scolaire.
Malgré tous ces efforts, la migration clandestine ne recule pas. Le chômage, la pauvreté et l'absence de perspectives continuent de pousser chaque année des milliers de jeunes Africains à risquer leur vie. Tant que les causes profondes ne seront pas résolues, ce phénomène perdurera et pourrait s'aggraver avec l'explosion démographique et la détérioration du tissu socio-économique en Afrique.
La lutte contre la migration clandestine passe donc par un développement inclusif et durable. Pour Sokodé et les autres villes d'Afrique endeuillées par ce fléau, il est urgent que les gouvernements réagissent pour redonner à leurs citoyens l'espoir d'un avenir meilleur sur leur propre continent. Car, comme l'a si bien résumé Aboubakari Razakou : « Vivre chez soi est encore mieux, si l'on peut y trouver les moyens de se réaliser. »
GRAND REPORTAGE -Sokodé : un miroir de la crise migratoire en Afrique